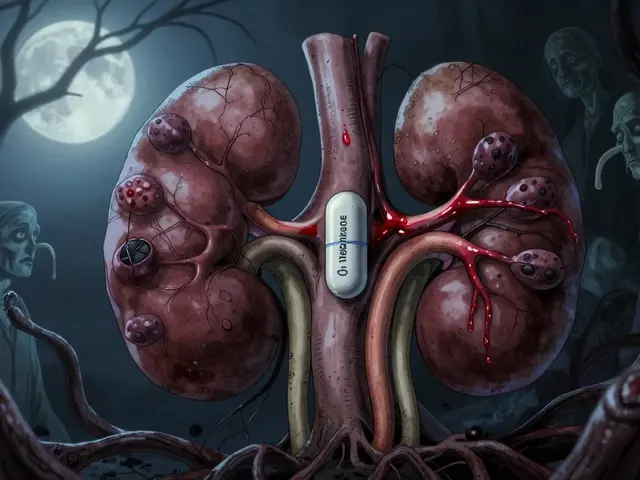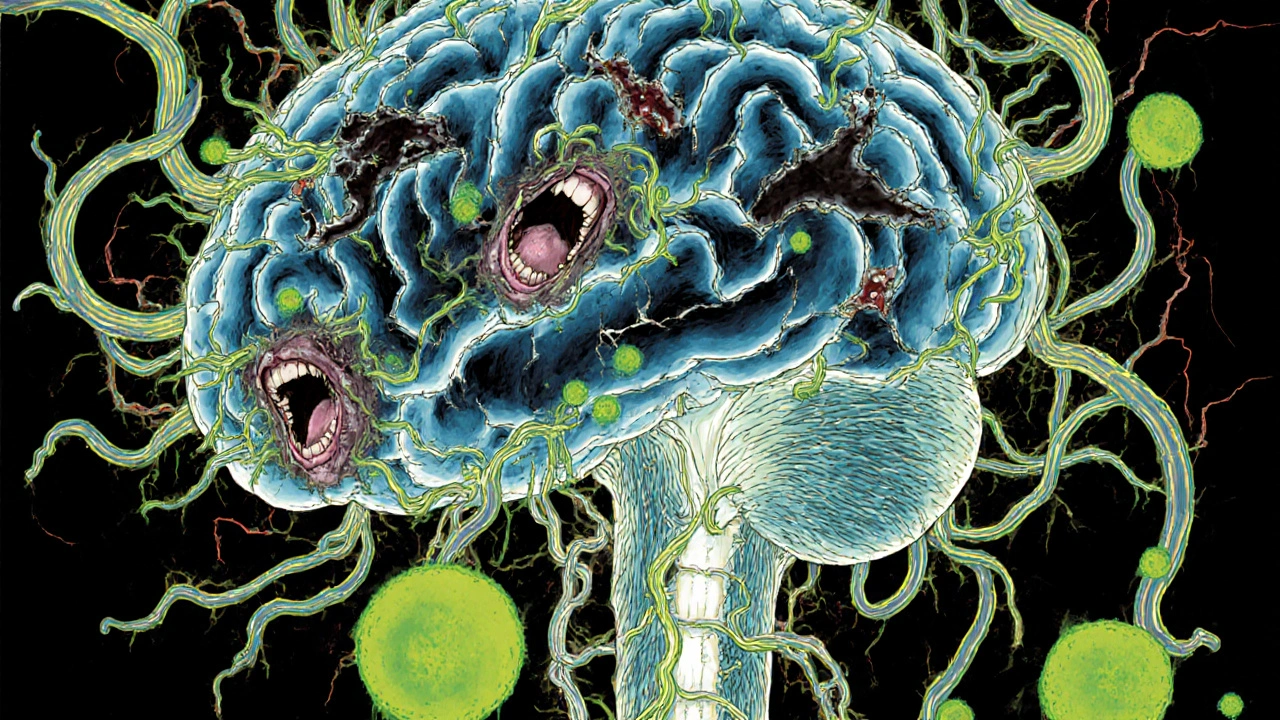
La sclérose en plaques n’est pas une maladie comme les autres. Elle ne vient pas d’un virus, ni d’un accident. Elle naît de l’intérieur : votre propre système immunitaire, celui qui devrait vous protéger, se retourne contre vous. Il attaque la gaine de myéline qui entoure vos nerfs, comme si ces nerfs étaient des ennemis. Et ce n’est pas une attaque ponctuelle. C’est une guerre silencieuse, qui se déroule dans le cerveau, la moelle épinière et les nerfs optiques - les parties les plus vitales de votre système nerveux central.
Comment ça commence ?
Chez les personnes en bonne santé, la barrière hémato-encéphalique agit comme une frontière étanche entre le sang et le cerveau. Elle laisse passer l’oxygène et les nutriments, mais bloque les cellules immunitaires dangereuses. Dans la sclérose en plaques, cette barrière se fissure. Des cellules T, des B et des macrophages - normalement destinées à combattre les infections - traversent cette frontière et pénètrent dans le système nerveux central. Là, elles croisent la myéline, cette gaine blanche qui enrobe les fibres nerveuses comme un isolant autour d’un câble électrique. Et elles la prennent pour une menace.
Elles déclenchent une inflammation. Elles détruisent la myéline. C’est ce qu’on appelle la démyélinisation. Sans cette gaine, les signaux électriques qui voyagent le long des nerfs ralentissent, se perdent, ou disparaissent complètement. C’est pourquoi une personne atteinte peut soudainement perdre la vue, ressentir des picotements dans les jambes, ou avoir du mal à marcher - même si son cerveau n’a pas subi de lésion mécanique. Le câble est intact, mais l’isolant a été arraché.
Les cellules qui attaquent
Il ne s’agit pas d’une seule cellule responsable. C’est une armée. Les cellules T CD4+, en particulier les sous-types Th17, sont les chefs de file. Elles libèrent des cytokines comme l’IL-21 et l’IL-22, qui activent d’autres cellules et augmentent l’inflammation. Des études montrent que ces cellules peuvent tuer des neurones humains en laboratoire, alors que les cellules T normales ne le peuvent pas.
Les cellules B, souvent oubliées dans les récits simplifiés, jouent un rôle crucial. Elles ne produisent pas seulement des anticorps - elles crachent des substances inflammatoires comme le TNF-α. Des recherches ont révélé que les cellules B de patients atteints de sclérose en plaques produisent jusqu’à 47 % plus de TNF-α que celles des personnes en bonne santé, surtout quand elles sont stimulées par l’interféron-gamma. C’est comme si leur système immunitaire était en mode surchauffe.
Puis il y a les microglies - les gardes du cerveau. Normalement, elles nettoient les déchets. Dans la sclérose en plaques, elles s’activent à 89 % dans les lésions chroniques. Elles deviennent agressives, libèrent des toxines, et participent à la dégradation des neurones. Ce n’est plus une attaque externe : c’est une révolte interne.
Les quatre types de lésions
La sclérose en plaques n’est pas une maladie unique. Elle se présente sous quatre formes pathologiques distinctes, observées au microscope sur des tissus cérébraux. Chaque type révèle un mécanisme différent.
Le schéma I montre une invasion massive de cellules T et de macrophages, comme une attaque frontale. Le schéma II ajoute des dépôts d’anticorps - une signature d’activité des cellules B. Le schéma III est plus inquiétant : il montre une perte sélective d’une protéine appelée MAG, essentielle à la stabilité de la myéline. Et le schéma IV est le plus sombre : les cellules qui fabriquent la myéline (les oligodendrocytes) sont mortes ou en détresse, et aucune réparation ne se produit. C’est comme si le cerveau avait perdu toute capacité à se réparer lui-même.
Ces différences expliquent pourquoi deux patients peuvent avoir des symptômes très différents, et pourquoi certains répondent à un traitement et pas à un autre. Ce n’est pas une maladie à un seul visage. C’est un puzzle complexe.

Les symptômes : quand le signal s’arrête
Les symptômes ne sont pas aléatoires. Ils suivent la localisation des lésions. Si la myéline est détruite sur le nerf optique, vous perdez la vision d’un œil - c’est ce qu’on appelle la névrite optique. Elle peut arriver en 24 à 48 heures, sans douleur, comme un écran qui se dégrade. Beaucoup de patients décrivent ça comme un voile qui tombe.
Si les lésions touchent la moelle épinière cervicale, vous pouvez ressentir le signe de Lhermitte : en baissant la tête, vous avez une décharge électrique qui traverse le dos, jusqu’aux jambes. C’est le signal nerveux qui court sur un câble sans isolant - un court-circuit.
La fatigue est présente chez 80 % des patients. Ce n’est pas une fatigue normale. C’est une lassitude profonde, qui ne passe pas avec le repos. Elle vient du cerveau qui doit travailler deux fois plus fort pour envoyer des signaux à travers des nerfs endommagés.
La perte de coordination, les engourdissements, les troubles de la vessie - tout cela est lié à la même cause : des nerfs qui ne transmettent plus correctement. 58 % des personnes rapportent des picotements, 42 % ont des difficultés à marcher. Et 37 % voient leur vision se brouiller.
Qui est touché ?
Près de 2,8 millions de personnes dans le monde vivent avec la sclérose en plaques. En Europe du Nord, au Canada, en Scandinavie, les taux sont jusqu’à quatre fois plus élevés. Pourquoi ? Parce que la maladie naît d’un mélange dangereux : une prédisposition génétique, et des déclencheurs environnementaux.
Le virus Epstein-Barr - responsable de la mononucléose - augmente le risque de développer la sclérose en plaques de 32 fois. La carence en vitamine D, fréquente dans les pays lointains du soleil, multiplie le risque de 60 %. Fumer augmente la progression de la maladie de 80 %. Et les femmes sont touchées deux à trois fois plus que les hommes - un mystère encore non résolu.
La maladie commence souvent entre 20 et 40 ans. C’est à cet âge-là que la plupart des gens construisent leur vie - une carrière, une famille. Et c’est là que la maladie frappe.
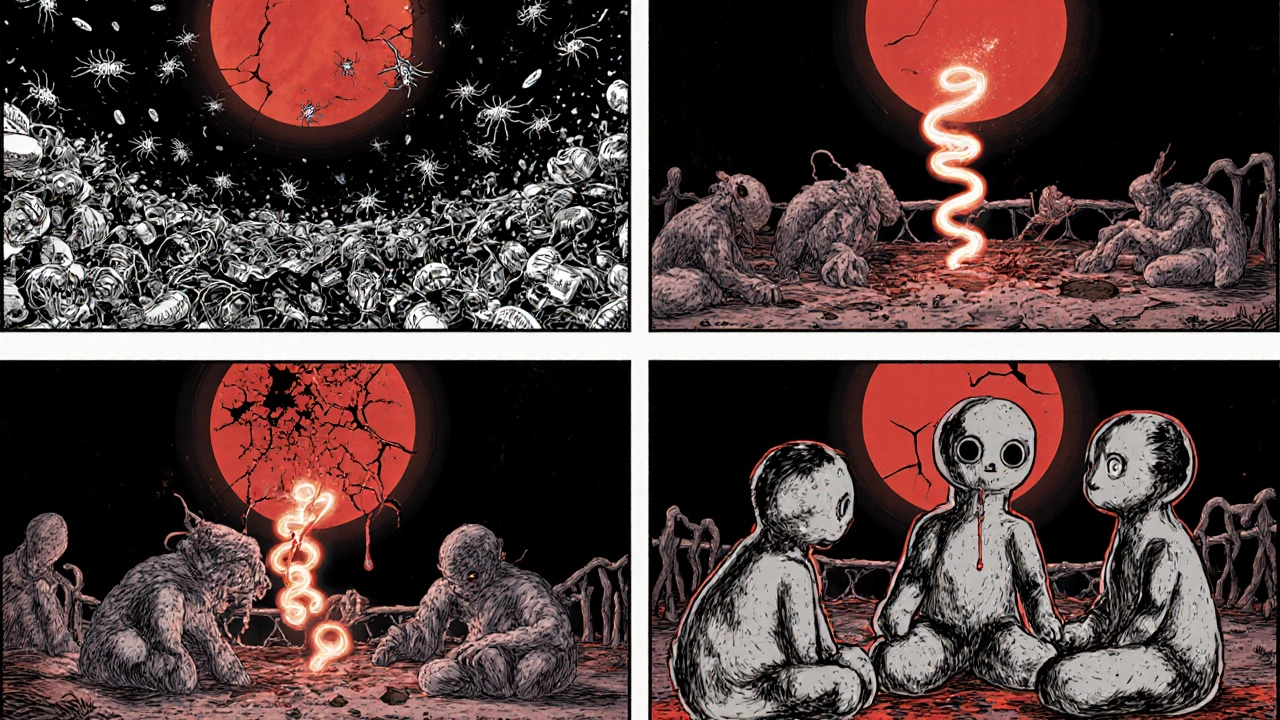
Les traitements : arrêter l’attaque, réparer les dégâts
Les traitements modernes ne guérissent pas. Mais ils changent tout.
Ocrelizumab, un traitement approuvé en 2017, cible les cellules B. Il réduit les poussées de 46 % chez les formes rémittentes, et ralentit la progression de 24 % chez les formes progressives. Natalizumab bloque les cellules immunitaires avant qu’elles n’atteignent le cerveau - il réduit les poussées de 68 %. Mais il y a un risque : une infection rare, la leucoencéphalopathie multifocale progressive (PML), qui touche 1 personne sur 1 000 après deux ans de traitement.
Et puis il y a l’espoir de la réparation. Des essais avec le clemastine fumarate ont montré une amélioration de 35 % dans la vitesse de transmission des signaux visuels - un signe clair que la myéline peut se régénérer. Ce n’est pas encore une cure. Mais c’est la première fois qu’on voit un traitement qui fait plus que ralentir la maladie : il répare.
Les chercheurs étudient maintenant les pièges des neutrophiles (NETs), qui détruisent la barrière hémato-encéphalique, et les cellules dendritiques qui présentent les antigènes de la myéline aux cellules T - comme si elles les incitaient à attaquer. C’est là que les futures thérapies pourraient se concentrer : déconnecter l’attaque, avant qu’elle ne commence.
Un avenir plus clair
La sclérose en plaques n’est plus une phrase sans issue. Les biomarqueurs comme la chaîne légère de neurofilaments (sNfL) permettent maintenant de mesurer l’activité de la maladie dans le sang. Si le taux dépasse 15 pg/mL, c’est qu’il y a une inflammation active - avec 89 % de précision. Cela permet d’ajuster les traitements avant que les dégâts ne deviennent irréversibles.
Le consortium International Progressive MS Alliance a investi 65 millions de dollars depuis 2014 dans la recherche sur les formes progressives - une somme jamais atteinte. Des projets sont en cours dans 14 pays. Et chaque année, des découvertes nouvelles changent la donne.
La sclérose en plaques n’est pas une maladie du passé. C’est une maladie de l’avenir - et nous sommes en train de la comprendre, pas seulement de la subir. Ce n’est pas une guerre perdue. C’est une guerre qu’on apprend à gagner, une cellule à la fois, un nerf à la fois, une réparation à la fois.
Commentaires (9)
- Franck Dupas
- novembre 13, 2025 AT 11:04
La sclérose en plaques, c’est comme si ton corps devenait un film d’horreur où le méchant, c’est toi-même 😅. Je trouve ça fou qu’on attaque ses propres nerfs… comme si ton cœur décidait un jour de faire un coup d’État contre ton corps. Et ce truc avec la myéline, c’est comme si quelqu’un découpait les câbles de ton wifi dans les murs… tu as encore la box, mais plus d’internet. 🤯
- Jacques Botha
- novembre 15, 2025 AT 03:43
On oublie toujours le vrai coupable : les OGM et les antennes 5G. Les laboratoires ont inventé cette maladie pour vendre des traitements à 10 000€ par mois. Regarde les chiffres : plus on développe de médicaments, plus on parle de « progression ». Coincidence ? Je pense pas. Ils veulent que tu restes malade pour toujours. La vérité est cachée sous des mots scientifiques pour que personne ne réfléchisse.
- sébastien jean
- novembre 15, 2025 AT 07:54
Erreur dans le texte : ‘démyélinisation’ est mal orthographié en bas de page. Et ‘interféron-gamma’ ne prend pas de trait d’union ici. De plus, ‘clemastine fumarate’ doit être écrit en minuscules sauf en début de phrase. Ce genre de négligence nuit à la crédibilité du contenu. On ne parle pas de maladies neurologiques comme si c’était un post Instagram.
- Anne Andersen
- novembre 15, 2025 AT 20:43
Il y a une beauté tragique dans cette maladie : elle révèle à quel point notre corps est à la fois fragile et incroyablement complexe. Ce n’est pas un ennemi extérieur, mais une dérive interne de notre propre défense. Cela nous oblige à repenser la notion même de santé - n’est-ce pas la santé, avant tout, une harmonie silencieuse entre nos systèmes ? Et quand cette harmonie se brise, ce n’est pas une guerre, c’est un échec de communication. Peut-être que la clé n’est pas de détruire, mais d’écouter.
- Kerstin Marie
- novembre 16, 2025 AT 05:43
Je trouve fascinant que les cellules B produisent 47 % plus de TNF-α chez les patients. Cela change complètement la vision qu’on avait de la maladie. On pensait que c’était juste les T qui étaient en cause, mais non - c’est un réseau entier qui déraille. Et cette idée que la réparation est possible avec le clemastine ? Ça donne de l’espoir. Pas une illusion, mais une piste concrète. On ne peut pas tout guérir, mais on peut apprendre à réparer.
- Dominique Faillard
- novembre 16, 2025 AT 21:59
Oh allez, arrêtez avec vos histoires de myéline. Personne ne sait ce qui cause vraiment la SP. Les gars du labo ont juste besoin de fonds. Tu crois vraiment que si tu prends un truc à 20 000€ par an, tu vas guérir ? Non. Tu vas juste payer pour qu’ils te disent que tu es ‘en rémission’. Et puis, pourquoi les femmes sont-elles plus touchées ? Parce qu’elles sont plus stressées ? Parce qu’elles portent des soutiens-gorge ? Je dis ça pour dérider, mais sérieusement, personne n’a la réponse. On fait des stats, on invente des schémas, et on vend des médicaments.
- Jonette Claeys
- novembre 18, 2025 AT 03:17
Ben voyons… un virus qui augmente le risque de 32 fois ? Et la vitamine D ? Et le tabac ? Et puis tout d’un coup, on veut qu’on croie que c’est ‘une guerre silencieuse’ ? C’est juste que les gens veulent croire qu’il y a un ‘sens’ derrière la maladie. Mais non. C’est du hasard. Du mauvais hasard. Et les traitements ? Des placebos avec des noms compliqués. Vous croyez que les gens qui ont 30 ans et qui apprennent qu’ils ont la SP vont se dire ‘ah oui, c’est le schéma III’ ? Non. Ils vont pleurer. Et puis se demander pourquoi ils ont mangé des frites à 15 ans.
- Julia Kazis
- novembre 18, 2025 AT 13:25
Je me demande si la myéline, ce n’est pas un peu comme la poésie du corps - une couche fine, invisible, qui permet à la vie de voyager sans heurt. Quand elle disparaît, ce n’est pas seulement un câble qui se dégrade. C’est une chanson qui s’arrête en plein milieu. Et ce qui est le plus triste, c’est que le cerveau, lui, continue de chanter… mais personne ne l’entend plus. La réparation, ce n’est pas juste remettre de la gaine. C’est apprendre à entendre à nouveau les silences.
- Poppy Willard
- novembre 20, 2025 AT 10:51
Je tiens à souligner l’importance de la précision terminologique dans ce domaine. Le terme ‘schéma’ est incorrect dans ce contexte ; il conviendrait d’utiliser ‘type histologique’ ou ‘profil immunopathologique’. De plus, la phrase ‘le câble est intact, mais l’isolant a été arraché’ est métaphoriquement élégante, mais peut induire en erreur les non-spécialistes. Une révision linguistique serait souhaitable pour assurer une diffusion claire et rigoureuse de ces informations cruciales.
Poster un commentaire
Catégories
Articles populaires