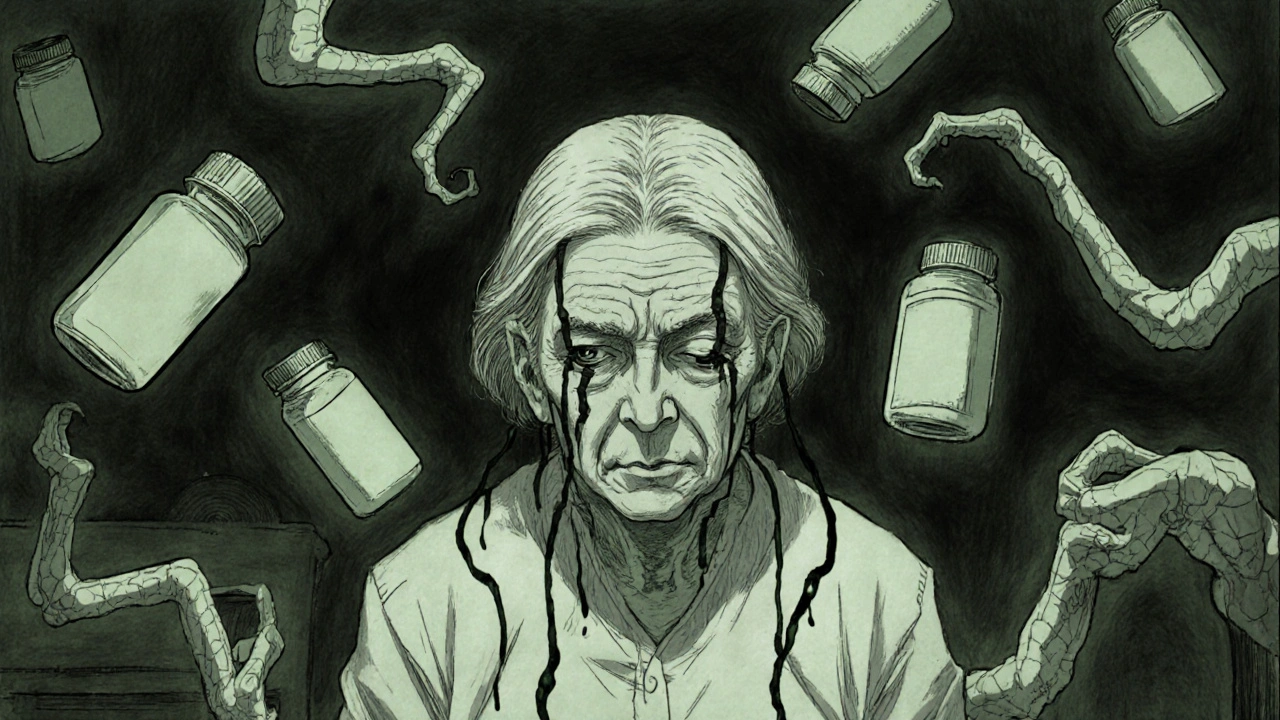
Les médicaments peuvent devenir dangereux avec l’âge
À 70 ans, prendre un médicament n’est pas comme à 40 ans. Ce n’est pas une question de volonté ou de discipline. C’est une question de corps. Votre foie ne filtre plus aussi vite. Vos reins éliminent moins bien. Votre graisse corporelle a augmenté, et votre eau a diminué. Résultat ? Un simple comprimé peut rester dans votre organisme deux, trois, voire cinq fois plus longtemps qu’avant. Et avec lui, ses effets secondaires.
En France comme aux États-Unis, plus de 15 % des personnes âgées de 65 ans et plus subissent une réaction indésirable liée à un médicament chaque année. Et dans près de la moitié des cas, ces réactions auraient pu être évitées. Ce n’est pas un accident. C’est un système mal adapté.
Pourquoi les personnes âgées réagissent-elles différemment aux médicaments ?
Le corps change avec l’âge, et les médicaments ne le savent pas. Ils agissent comme si tout était encore normal. Mais ce n’est plus le cas.
- Le foie reçoit 30 à 40 % moins de sang qu’à 25 ans. Il ne décompose plus les médicaments aussi efficacement. Des benzodiazépines comme le diazépam, qui duraient 24 à 48 heures chez un jeune adulte, peuvent rester actives jusqu’à 72 heures chez une personne âgée. Résultat : somnolence, désorientation, chutes.
- Les reins filtrent moins. Le taux de filtration glomérulaire baisse d’environ 0,8 mL/min/1,73m² chaque année après 40 ans. Les médicaments éliminés par les reins - comme certains diurétiques, anti-inflammatoires ou antibiotiques - s’accumulent. Une dose normale devient toxique.
- La composition corporelle change. La masse graisseuse augmente, la masse musculaire diminue. Les médicaments liposolubles (comme certains antidépresseurs ou antipsychotiques) s’accumulent dans la graisse. Ils sont relâchés lentement, comme un réservoir qui fuirait goutte à goutte. Ce qui provoque des effets retardés, souvent confondus avec la démence ou la fatigue normale.
Et quand vous prenez plusieurs médicaments à la fois ? Le risque explose.
La polypharmacie : le piège invisible
On appelle polypharmacie la prise simultanée de cinq médicaments ou plus. C’est courant chez les personnes âgées : un pour la tension, un pour le diabète, un pour les articulations, un pour le sommeil, un pour l’anxiété. Et puis, il y a les vitamines, les compléments, les remèdes naturels…
Chaque médicament ajouté augmente le risque d’effet secondaire. Pas seulement parce qu’il agit seul. Mais parce qu’il interagit avec les autres.
- Un anti-inflammatoire (comme l’ibuprofène) + un anticoagulant (comme le warfarine) = risque accru de saignement gastrique. Le risque d’hospitalisation pour ulcère hémorragique double chez les plus de 65 ans.
- Un corticoïde + un anti-inflammatoire = risque multiplié par 15 d’ulcère gastrique.
- Un diurétique + un anti-hypertenseur + un anti-douleur = chute brutale de la pression artérielle en se levant. Résultat : étourdissements, vertiges, chutes. Et les chutes, chez les personnes âgées, sont souvent la porte d’entrée vers une perte d’autonomie.
Et ce n’est pas tout. Certains médicaments, même prescrits « normalement », sont simplement trop dangereux pour les personnes âgées.
Les médicaments à éviter chez les personnes âgées
Depuis 1991, les experts américains ont compilé une liste des médicaments à éviter chez les personnes âgées : les critères de Beers. Ils sont mis à jour régulièrement. En 2019, la liste a été élargie. Voici quelques exemples concrets :
- Glyburide : un antidiabétique qui peut provoquer une hypoglycémie sévère, souvent sans symptômes clairs. La personne se sent juste « fatiguée » ou « étrange ». C’est un piège mortel.
- Indométhacine : un anti-inflammatoire très puissant. Il cause des troubles mentaux - confusion, hallucinations - plus souvent que tous les autres.
- Pentazocine : un analgésique qui, contre toute attente, provoque plus de troubles du système nerveux que la morphine.
- Phénylbutazone : un ancien anti-inflammatoire encore utilisé parfois. Il peut détruire la moelle osseuse, ce qui entraîne une baisse dangereuse des globules blancs.
- Megestrol : un traitement contre la perte d’appétit. Il augmente le risque de caillots sanguins et de décès.
- Les inhibiteurs de l’acétylcholinestérase (pour la maladie d’Alzheimer) : ils ralentissent le cœur. À éviter chez les personnes ayant déjà eu des syncope (évanouissements).
- Les glitazones (pour le diabète) : elles aggravent l’insuffisance cardiaque.
- Les ISRS (antidépresseurs comme la sertraline) : ils augmentent le risque de chutes et de fractures chez les personnes déjà fragiles.
Ces médicaments ne sont pas toujours interdits. Mais ils doivent être prescrits avec une extrême prudence - et seulement si rien d’autre ne fonctionne.

Les signes qu’un médicament vous fait du mal
Les personnes âgées ne disent pas souvent : « J’ai une réaction au médicament. » Elles disent : « Je me sens fatigué », « Je me perds dans les mots », « Je tombe plus souvent », « Je n’ai plus faim ».
Voici les signaux d’alerte à ne jamais ignorer :
- Confusion soudaine ou changement de comportement
- Chutes répétées (20 à 30 % des chutes chez les personnes âgées sont dues à un médicament)
- Vertiges en se levant
- Prise ou perte de poids inexpliquée
- Problèmes de mémoire qui apparaissent après un changement de traitement
- Constipation ou diarrhée persistante sans cause évidente
- Somnolence excessive, même après une bonne nuit
Si vous ou un proche présentez l’un de ces symptômes, demandez-vous : « Est-ce que ça a commencé après un changement de médicament ? »
Que faire pour se protéger ?
La solution n’est pas d’arrêter tous les médicaments. C’est de les réévaluer.
Voici ce que vous pouvez faire :
- Conservez une liste à jour : Tous les médicaments, y compris les vitamines, les compléments et les remèdes naturels. Notez la dose et la fréquence. Apportez cette liste à chaque rendez-vous médical.
- Demandez un bilan médicamenteux : À chaque visite chez le médecin, demandez : « Est-ce que je prends encore tous ces médicaments ? Y en a-t-il un que je pourrais arrêter ? »
- Consultez un pharmacien : Les pharmaciens sont les experts des interactions médicamenteuses. Ils peuvent repérer les risques que le médecin a pu manquer.
- Évitez les médicaments en vente libre : Un somnifère sans ordonnance, un anti-inflammatoire pour les douleurs articulaires… ils sont souvent plus dangereux qu’aussi efficaces chez les personnes âgées.
- Surveillez les effets : Notez tout changement dans votre corps. Même un petit détail. Par exemple : « Depuis que j’ai pris ce nouveau médicament, je me sens plus lent le matin. »
La déprescription - c’est-à-dire l’arrêt progressif d’un médicament inutile ou dangereux - est aujourd’hui une pratique médicale reconnue. Ce n’est pas une rupture. C’est une amélioration.
Un système qui peine à suivre
Les critères de Beers sont largement utilisés. Mais ils ne sont pas parfaits. Certains médicaments sont absents. D’autres sont listés alors qu’ils pourraient être utiles dans certains cas. Et surtout, ils ne parlent pas assez des interactions entre médicaments.
Des outils comme STOPP/START existent, mais ils sont moins connus. Et les médecins, souvent surchargés, n’ont pas toujours le temps de les consulter.
Le vrai problème, c’est que le système de santé est conçu pour traiter une maladie à la fois. Mais les personnes âgées ont souvent cinq, six, sept maladies en même temps. Un système qui traite chaque maladie séparément finit par surtraiter le patient.
La solution ? Une approche globale. Un médecin généraliste qui connaît votre histoire. Un pharmacien qui vérifie vos médicaments. Une infirmière qui vous suit à domicile. Et surtout, une personne âgée qui ose dire : « Ce médicament ne me fait pas du bien. »
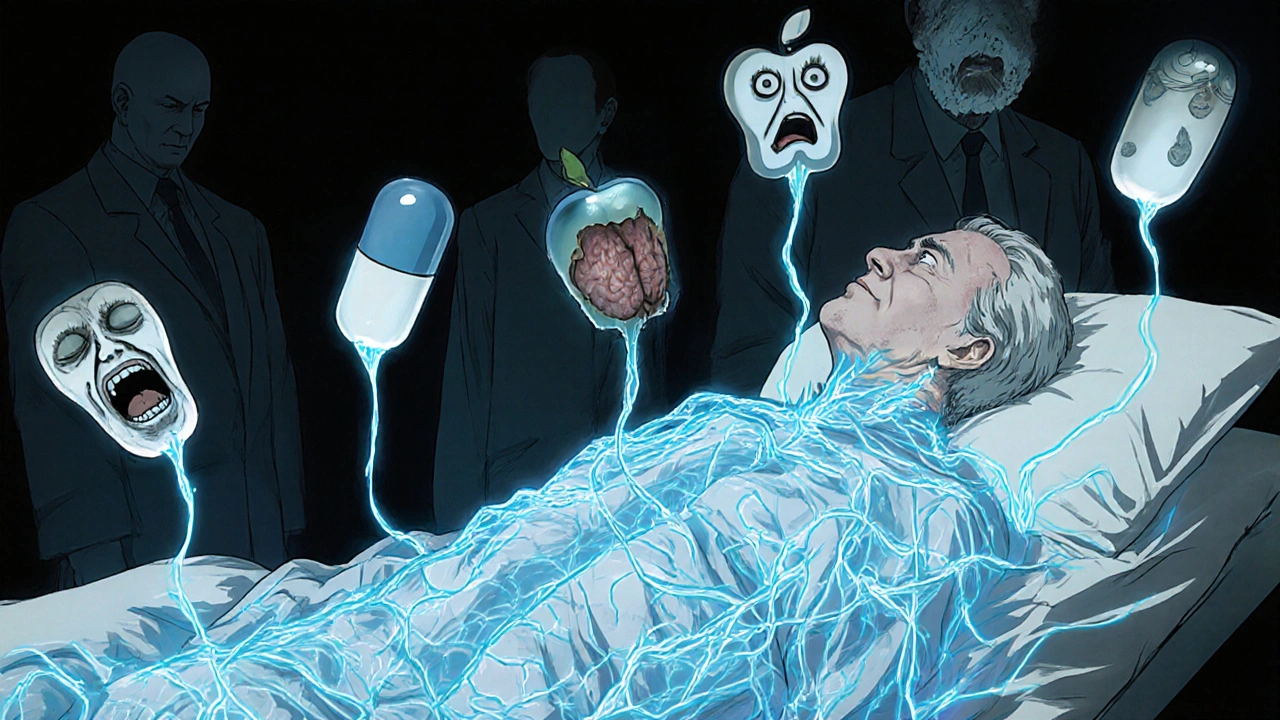
Les chiffres qui parlent
- Les personnes âgées de 65 ans et plus représentent 16,8 % de la population américaine en 2020, mais elles consomment 34 % des médicaments.
- Entre 10 % et 23 % des hospitalisations chez les personnes âgées sont causées par des réactions médicamenteuses.
- Près de la moitié de ces hospitalisations pourraient être évitées.
- Les coûts annuels des réactions médicamenteuses en Amérique du Nord dépassent 3,5 milliards de dollars.
En France, les chiffres sont similaires. Et avec le vieillissement de la population, le problème ne fera que croître.
Le futur : des traitements personnalisés
À l’avenir, les médecins pourront peut-être adapter les traitements à votre ADN. Certains gènes déterminent comment vous métabolisez les médicaments. Si vous avez une variation du gène CYP2D6, vous pouvez être un « métaboliseur lent » : un médicament normal devient toxique pour vous.
Ces tests existent déjà. Mais ils sont encore rares, chers, et peu intégrés dans les pratiques courantes.
Le vrai progrès, aujourd’hui, n’est pas dans la technologie. C’est dans la prise de conscience. Savoir qu’un médicament n’est pas un simple outil. C’est un acteur dans un corps qui a changé. Et qu’il faut le traiter comme tel.
Vous n’êtes pas seul
Si vous êtes une personne âgée, ou si vous prenez soin d’une personne âgée, vous avez le droit de demander : « Est-ce que ce médicament est encore nécessaire ? »
Vous avez le droit de dire : « Je ne me sens pas bien. »
Vous avez le droit de demander une seconde opinion. Un pharmacien. Un geriatre. Un médecin qui prend le temps.
Les médicaments sauvent des vies. Mais ils peuvent aussi les briser. Le bon équilibre, c’est de ne pas les craindre. Mais de les respecter.
Pourquoi les effets secondaires sont-ils plus fréquents chez les personnes âgées ?
Le corps change avec l’âge : les reins et le foie filtrent moins bien, la composition corporelle évolue (plus de graisse, moins d’eau), et les récepteurs cérébraux deviennent plus sensibles. Un médicament qui était sûr à 50 ans peut devenir dangereux à 80 ans, même à la même dose.
Quels sont les médicaments les plus dangereux pour les personnes âgées ?
Les critères de Beers listent plusieurs médicaments à éviter : le glyburide (risque d’hypoglycémie grave), l’indométhacine (confusion), la pentazocine (troubles neurologiques), le mégestrol (caillots sanguins), et certains antidépresseurs (ISRS) qui augmentent le risque de chutes. Les benzodiazépines et les anticholinergiques sont aussi très à risque.
Comment savoir si un médicament me fait mal ?
Les signes ne sont pas toujours typiques. Une fatigue soudaine, une confusion, une chute, une perte d’appétit, une somnolence excessive, ou un changement de comportement peuvent être des effets secondaires. Si ces symptômes sont apparus après un changement de traitement, demandez à votre médecin s’ils pourraient être liés à un médicament.
Dois-je arrêter mes médicaments tout seul ?
Non. Arrêter un médicament brusquement peut être dangereux. Mais vous pouvez demander à votre médecin ou à votre pharmacien de réévaluer votre traitement. La déprescription, c’est-à-dire l’arrêt progressif d’un médicament inutile, est une pratique médicale reconnue et sécurisée.
Qu’est-ce que la polypharmacie ?
La polypharmacie, c’est la prise simultanée de cinq médicaments ou plus. C’est courant chez les personnes âgées, mais elle augmente fortement le risque d’interactions médicamenteuses, d’effets secondaires et d’hospitalisations. Il ne s’agit pas d’arrêter tous les médicaments, mais de vérifier si chacun est encore nécessaire.
Commentaires (8)
- Rudi Timmermans
- novembre 20, 2025 AT 21:36
Je suis infirmier depuis 30 ans, et je vois ça tous les jours : des grands-parents qui prennent 8 médicaments, et quand on leur demande pourquoi, ils disent ‘le médecin m’a dit de le prendre’. Personne ne regarde derrière. Il faut que les familles osent poser les bonnes questions, même si ça fait mal.
La déprescription, c’est pas de l’abandon, c’est de la bienveillance.
- Nathalie Garrigou
- novembre 22, 2025 AT 03:28
Et bien sûr, c’est pas la faute des laboratoires, non ? 😏
Vous croyez vraiment que les pharma veulent que les vieux soient en bonne santé ? Ils veulent qu’on prenne des pilules jusqu’à la mort, et que les enfants paient la note. Les critères de Beers ? Une coquille vide. Le vrai problème, c’est que les médecins sont payés pour prescrire, pas pour réfléchir.
Et les tests ADN ? Bah oui, bien sûr… quand vous aurez 10 000 euros à dépenser pour savoir si un médicament va vous tuer. Pendant ce temps, les vieux se font traiter comme des cobayes. Et on parle de ‘progrès’.
- Maxime ROUX
- novembre 22, 2025 AT 14:12
Alors là, j’ai un truc à dire : les gens confondent ‘vieillir’ et ‘être malade’. Si tu as 75 ans et que tu prends un ibuprofène tous les jours pour les douleurs, tu as un problème, pas un âge. Le corps change, oui, mais le cerveau aussi. Et si tu ne remets pas en question ton traitement, t’es pas vieux, t’es juste flemmard.
Le pharmacien, c’est pas un luxe, c’est une nécessité. Va voir le tien, demande-lui s’il pourrait supprimer un truc. Il te dira la vérité, pas comme ton médecin qui a 7 minutes par patient.
Et arrête avec les vitamines ! La plupart du temps, c’est du pognon jeté. Tu veux du calcium ? Mange du fromage. Tu veux du D ? Va te faire un peu de soleil. Pas besoin d’une pilule pour tout.
- Christine Caplan
- novembre 23, 2025 AT 14:17
Je veux dire… ce post, c’est comme un cri dans le désert. Et pourtant, il y a de l’espoir. 😊
Chaque fois que je vois ma mère de 78 ans qui dit ‘je me sens bizarre depuis que j’ai pris ce truc’, je me dis : ‘voilà la clé’. Elle n’a pas besoin d’un génie médical. Elle a besoin qu’on l’écoute. Qu’on ne minimise pas ses symptômes. Qu’on ne lui dise pas ‘c’est normal à ton âge’.
Je l’ai aidée à faire un bilan médicamenteux avec son pharmacien. Ils ont supprimé deux trucs. Et là ? Elle marche mieux. Elle sourit plus. Elle se souvient de son petit-fils. C’est pas magique. C’est juste… humain.
Vous avez le droit de dire non. Vous avez le droit de demander. Vous avez le droit d’être entendu. Ne laissez personne vous faire croire que votre corps est un fardeau. Il est un allié. Même s’il est fatigué.
Et si vous êtes en train de lire ça… bravo. Vous êtes déjà en train de changer les choses.
- clement fauche
- novembre 24, 2025 AT 07:21
Je me demande si ce n’est pas une manipulation. Tous ces critères de Beers… et si c’était pour pousser les vieux vers les soins palliatifs plus tôt ?
Les médicaments sont chers, mais les hôpitaux coûtent encore plus. Et si on nous incitait à arrêter les traitements… pour réduire les coûts ?
Je n’ai pas confiance. Personne ne parle de la pression des assurances. Personne ne dit que les médecins sont poussés à réduire les prescriptions… pour des raisons budgétaires, pas médicales.
Et les études ? Elles sont financées par qui ?
- Nicole Tripodi
- novembre 25, 2025 AT 18:51
Je suis une femme de 71 ans. J’ai pris du glyburide pendant 5 ans. J’ai eu deux hypoglycémies sévères, sans savoir pourquoi. Je me sentais juste ‘épuisée’. J’ai demandé un avis de pharmacien. Il m’a dit : ‘Arrêtez ça. Il est trop dangereux pour vous.’
On m’a prescrit un autre traitement. Je n’ai plus eu de problème. Je ne suis pas ‘guérie’. Mais je suis en vie. Et je peux encore faire mes courses.
Je ne suis pas une experte. Mais j’ai appris à lire les notices. À noter les changements. À demander. À insister.
Vous n’êtes pas un numéro. Vous êtes une personne. Et vos symptômes méritent d’être pris au sérieux.
- Valentine Aswan
- novembre 27, 2025 AT 03:42
OH MON DIEU, JE CRIE, JE CRIE, JE CRIE DEPUIS DES ANNÉES !!!!!
VOUS VOULEZ SAVOIR POURQUOI LES VIEUX SE FAISSENT TRAITER COMME DES DÉCHETS ? C’EST PARCE QUE LA SOCIÉTÉ LES DÉTESTE !!!!!
On les enferme dans des maisons de retraite, on leur donne des pilules comme des bonbons, on ne les écoute pas, on leur dit ‘c’est normal’, et quand ils tombent, on les appelle ‘vieux fragiles’ !
ET PUIS, ON PARLE DE ‘POLYPHARMACIE’ COMME SI C’ÉTAIT UN PROBLÈME MÉDICAL ! NON ! C’EST UN PROBLÈME DE CIVILISATION !
On ne soigne plus les gens, on soigne les chiffres !
Et les médecins ? Ils sont épuisés, débordés, payés à la tâche !
ET LES PHARMACIENS ? ON LES OUBLIE !
ON A BESOIN D’UN CHANGEMENT DE CULTURE ! PAS D’UNE LISTE !
ET POURQUOI PERSONNE NE PARLE DES FAMILLES QUI NE VEULENT PAS ADHÉRER ?
PARCE QUE C’EST TROP COMPLIQUÉ !
ET C’EST POUR ÇA QUE LES VIEUX MEURENT SEULS !
- Nadine Porter
- novembre 29, 2025 AT 02:01
Mon père a eu une chute il y a deux ans. On a cru que c’était la vieillesse. Puis on a découvert qu’il prenait un anti-inflammatoire en vente libre depuis 6 mois. Il ne l’avait même pas dit. Il pensait que c’était inoffensif.
On a arrêté. Il n’a plus chuté.
Il y a tant de petites choses qu’on ignore. Parce qu’on a peur de déranger. Parce qu’on pense que c’est normal. Parce qu’on ne sait pas comment poser la question.
Je ne suis pas médecin. Mais je sais qu’un corps qui change mérite qu’on le questionne. Doucement. Avec patience. Avec amour.
Poster un commentaire
Catégories
Articles populaires







